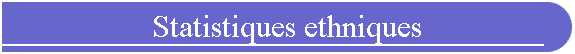
Actualité immédiate sur http://mrapnancy.over-blog.com
Actualité immédiate sur http://mrapnancy.over-blog.com |
|
QUELQUES REFLEXIONS ET INFORMATIONS SUR LA QUESTION DES « STATISTIQUES ETHNIQUES » PLAN : - La virulente polémique des années 1990 La discussion sur le point de savoir s’il faut (ou non) permettre d’établir des statistiques à caractère « ethnique » est déjà ancienne ; à plusieurs reprises, ce débat a fait rage en France. Très récemment, la polémique a connu un rebondissement, avec le débat du nouveau projet de loi sur l’immigration à l’Assemblée nationale puis au Sénat. Jusqu’ici, la législation applicable à cette question est la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans l’article 8 premier alinéa de cette loi, est posé le principe suivant : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou la vie sexuelle de celles-ci. » L‘alinéa II du même article de cette loi comporte une énumération des exceptions qui peuvent être apportées à ce principe (par exemple pour tous les traitements de données visant à préserver des vies humaines, relatifs à la médecine préventive, etc.) L’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), instituée par cette même loi du 06 janvier 1978, doit être sollicitée pour toute enquête qui pourra entraîner le traitement informatique de données faisant apparaître, « directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques » des personnes. Le nouveau projet de loi « relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile », soumis au débat de l’Assemblée nationale à partir du 18 septembre 2007 (où il a été adopté en première lecture le 19 septembre) et du Sénat à partir du 02 octobre 2007, introduit des modifications de la loi de 1978. L’article 20 de ce projet de loi « relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile » (version votée le 19 septembre 2007) ajoute, premièrement, un nouveau « 9° » à la liste des exceptions énumérées par l’alinéa II de l’article 8 de la loi du 06 janvier 1978. Ainsi seraient aussi autorisés, par dérogation au principe de l’alinéa I précité, « les traitements » (de données) « nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration ». Les modalités de ces collectes et traitement de données doivent suivre l’article 25 de la même loi de 1978. A cette fin, un nouveau « 9° » doit être ajouté à l’alinéa I de cet article 25. Cet ajout doit permettre, est-il précisé là encore, « les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration ». Il est précisé que, « lorsque la complexité de l’étude le justifie, la commission (note : la CNIL) peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d’un mois pour transmettre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. » En cas d’absence d’une opposition explicite de la part de ce comité, qui serait créé par un décret du gouvernement, celui-ci serait donc automatiquement favorable à la collecte de données concernée. Cet article 20 du projet de loi relatif à l’immigration et au droit d’asile a été inséré, le 13 septembre 2007, par un amendement déposé en Commission des lois de l’Assemblée nationale. Les deux auteurs de l’amendement, les députés UMP Michèle Tabarot (Alpes-Martimes) et Sébastien Huyghe (Nord), ont justifié leur proposition par la volonté de combattre plus efficacement les discriminations : « Pour lutter contre les discriminations, encore faut-il pouvoir les identifier, les mesurer. » Cependant des voix critiques se sont rapidement élevées, qui craignent plutôt qu’une telle pratique du traitement de données « ethniques » ne conduise à des dérives, et contribue elle-même à créer ou renforcer des discriminations. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, s’est ainsi interrogé : « Ses auteurs voudraient-ils signifier, peut-être de façon inconsciente, que les 'minorités visibles' ne sont pas totalement françaises? » (Source des citations : Le Monde du 14 septembre 2007.) De son côté, le MRAP a estimé, dans un communiqué publié le 17 septembre 2007, « que l’introduction de certains critères statistiques ethniques représente un véritable danger qui pourrait se traduire par la légalisation de logiques de classement et de tri sur des bases ethniques. Sans compter l’instrumentalisation de ces données qui pourrait participer à l’ethnicisation de problèmes de société. » Avant de revenir sur les arguments invoqués dans ce débat « pour » ou « contre » l’introduction de statistiques dites ethniques, retraçons brièvement le débat de ces dernières années autour de la question. La virulente polémique des années 1990 Pour la première fois, c’est au début des années 1990 qu’a été menée une étude qui impliquait une collecte de données « ethniques ». Jusque-là, le seul critère de distinction autorisé (sous le contrôle de la CNIL) était celui de la nationalité, autrement dit la distinction entre ressortissants français et personnes ayant un passeport étranger. Ce critère pouvait, dans les collectes de données relatives aux personnes, être ajouté à ceux de la date et du lieu de naissance etc. La démographe Michèle Tribalat, spécialiste des statistiques relatives à l’immigration, a « brisé le ‘tabou français’ » (selon une expression du quotidien Le Monde du 06 novembre 1998) à travers deux études. Dans une enquête sur « l’apport de l’immigration » à la population française, élaborée en 1991 et 1992 pour le compte de l’Institut national d’études démographiques (INED), la spécialiste avait introduit de nouveaux repères. « Dans cette enquête, Michèle Tribalat ne se contente plus de demander la nationalité des enquêtés, comme dans les recensements faits par l’INSEE. Elle recourt à deux nouveaux critères : ‘l’appartenance ethnique’, fondée sur la langue maternelle, et ‘l’origine ethnique’, définie par le lieu de naissance des parents. Elle finit par distinguer, d’après ses origines étrangères, une minorité immigrée d’une catégorie majoritaires qu’elle appelle ‘Français de souche’. » (Citation tirée du Nouvel Observateur, 19-25 novembre 1998.) Auparavant, une telle catégorisation, conduisant à faire des distinctions entre personnes possédant toutes la nationalité française, n’avait pas été admise. En 1995, dans une étude sur « l’intégration » cette fois-ci, Michèle Tribalat allait utiliser les mêmes critères. La motivation de Michèle Tribalat reposait sur une volonté de « décrire le réel au mieux », selon sa propre formulation. Par ailleurs, la démographe pensait avoir forgé des instruments de lutte pour contrer les discriminations racistes : « Savoir que le taux de chômage s’envole à 40 % chez les Maghrébins de 20-29 ans, c’est une information capitale sur les phénomènes d’exclusion socio-économiques. » Selon ses propres mots, Madame Tribalat ne craignait pas d’avoir contribué à l’exacerbation des discriminations, ou à répandre une vision « ethnicisante » des rapports sociaux : « Notre société n’a pas attendu que nous forgions nos outils d’analyse pour être fortement ethnicisée. » Autrement dit, pour elle, « ethnicisée », la société l’était déjà ; et maintenant, il s’agissait selon elle de mieux mesurer, décrire et analyser cette réalité-là. Néanmoins son approche n’était pas exempte de critiques. Ainsi certains auteurs ont-ils cru pouvoir détecter des problèmes méthodologiques ou des contradictions dans son approche. « Chez Tribalat, les Européens sont classés par nationalité, qu’elle appelle ‘ethnie’ par commodité : elle invente une ‘ethnie portugaise’, une ‘ethnie italienne’, etc. Dès qu’on traverse la Méditerranée, les détails s’affinent, les nations s’effacent : les Algériens, par exemple, sont soit kabyles, soit arabes… Quand on parvient en Afrique noire, le souci du détail devient plus extrême encore, et moins pertinent… » (V. Ursula Gauthier : « Des dérapages racistes à l’INED ? », Nouvel Observateur du 19. 11. 1998.) Michèle Tribalat fut, à l’époque, durement attaquée par des collègues scientifiques, et particulièrement par le démographe et chercheur Hervé Le Bras. Sa critique portait en partie sur la méthode choisie : « Enfin Hervé Le Bras accuse Mme. Tribalat de pratiquer une ‘ethnique de pacotille’ en analysant les difficiles parcours d’intégration des immigrés en fonction de leurs origines. Pis, elle réserverait aux étrangers une division ethnique contestable d’un point de vue anthropologique, tandis que la variable nationale suffirait quand il s’agirait de décrire des Européens. » L’étude de Mme. Tribalat décèle, selon cette critique, « ‘du Kurde sous le Turc, du Kabyle sous l’Algérien et du Berbère sous le Marocain’, faisant fi des frontières nationales ». (V. Philippe Bernard et Nicolas Weill : « Une virulente polémique sur les données ‘ethniques’ divise les démographes », Le Monde, 06. 11. 1998.) Par ailleurs, M. Le Bras critiquait aussi le fond de l’approche de sa collègue, dans sa totalité. Selon lui, la démographie française était à ce moment-là « en passe de devenir un moyen d’expression du racisme. » Selon lui, l’utilisation de l’expression « Français de souche » en serait le signe le plus clair : « ‘Du français de souche, on glisse insensiblement vers l’Indo-Européen’, cher à l’extrême droite… » (op. cit.) Le violent débat qui opposait alors Hervé Le Bras aux structures de l’Institut national d’études démographiques (INED), et dont l’apogée allait être le procès en diffamation intenté par l’INED contre lui en novembre 1998 – n’aboutissant pas à une condamnation – ( à supprimer ici et mettre avant le tiret : en novembre 1998), avait pour toile de fond l’influence grandissante de l’extrême droite. Cette dernière était à l’époque aussi présente au sein de l’INED, à travers une figure comme Philippe Boursier du Carbon, qui était alors membre de cet institut, militant encarté du Front national (FN) et « conseiller scientifique » de Jean-Marie Le Pen. Le vice-président du conseil scientifique de l’INED à l’époque, Jacques Dupâquier, avait participé à un colloque organisé par une association proche du FN sur le « baptême de Clovis » en août 1996. Michèle Tribalat n’appartenait point à ce même camp politique. Au contraire, elle se plaçait dans une optique de lutte contre les discriminations, et de la promotion d’une République des diversités. Les deux conceptions défendues respectivement par Mme. Tribalat et M. Le Bras furent d’ailleurs, à cette époque, qualifiées de « deux versions fortes de la gauche républicaine » par François Héran, chercheur à l’INSEE et à l’INED. (V. Philippe Bernard et Nicolas Weill : « Deux ‘versions fortes’ de la gauche républicaine », Le Monde, 06. 11. 1998) Cependant les tentatives de la part de la droite dure et de l’extrême droite, présentes dans le paysage scientifique de la démographie, ne manquèrent pas. Le point culminant de la campagne menée par ces dernières fut un colloque organisé le 17 octobre 1997 à l’Académie des sciences morales et politiques sous la direction de Monsieur Dupâquier. (Les actes de ce colloque, sous le titre « Morales et politiques d’immigration », seront publiés en juin 1998 aux PUF.) On pouvait y rencontrer notamment - Philippe Boursier de Carbon (précité), - Henry de Lesquen, président du Club de l’Horloge, un centre de production intellectuelle positionné à la charnière entre droite dure et extrême droite, - Pierre Bernard, le maire de Montfermeil proche de Philippe de Villiers et condamné à plusieurs reprises pour discrimination raciste pour avoir, par exemple, refusé d’inscrire des enfants d’immigrés dans les écoles de sa commune, - Alain Griotteray, maire de Charenton (jusqu’en 2001), ex-UDF, proche de Charles Million du parti La Droite et partisan déclaré d’alliances entre la droite classique et le FN (allant appeler à voter pour Marine Le Pen au second tour des législatives de juin 2007), - ainsi que deux députés de la droite classique : Alain Madelin et Alain Marsaud. Michèle Tribalat était aussi invitée à venir s’exprimer à ce colloque, ce qu’elle fit. Cela dit, elle allait déclarer, plus tard, qu’elle avait été « piégée » par Jacques Dupâquier qui lui avait proposé de venir « sans (lui) donner la liste des invités ». Cependant l’intérêt apparent que pouvait avoir la méthode introduite et utilisée par elle, aux yeux des illustres participants à ce colloque ou au moins de certains d’entre eux, était évident. Ces derniers aspiraient à un traitement différencié entre groupes de la population française, en fonction d’un classement de la population en différentes catégories ethniques. Un participant du colloque d’octobre 1997, non désigné nominativement, est ainsi cité par l’article du Nouvel Observateur : « Ce n’est pas l’immigration qui est à craindre. En réalité, nous sommes menacés par des citoyens français ex-immigrés ! » (Cité d’après l’article précité du Nouvel Observateur.) Puisque l’extrême droite apparaissait assez menaçante sur la scène politique française, en cette même année 1998, les différents courants du camp républicain allaient renoncer, finalement, à s’affronter plus durement encore. A partir de la fin 1998, la polémique se calmait. Hervé Le Bras, opposé à l’époque aux démographes de l’INED, déclarait par ailleurs qu’il ne serait pas véritablement contre une collecte d’informations à caractère « ethnique », à condition qu’elle serve un objectif pratique et concret de lutte contre les discriminations, et qu’elle soit acceptée par les premiers concernés. Il y ajoutait : « Si l’on pense que la proportion de mélanine est variable discriminante pour permettre l’étude des difficultés d’intégration dans une situation locale, pourquoi pas ? Mais il serait fou d’inclure une telle variable dans un recensement national. » Ainsi, le futur débat allait plutôt porter sur les questions d’admissibilité de la collecte de certaines données, que sur des principes fondamentaux. Cependant, tant que l’extrême droite apparaissait forte et risquait fortement de s’accaparer du thème des « catégories ethniques » dans la population, ce débat n’allait pas aboutir. Il restait bloqué tant que le danger de l’instrumentalisation politique – à des fins tout à fait contraires à la lutte contre les discriminations – paraissait visible, palpable, et immédiat. Autour des années de 2000 à 2005, le débat allait cependant connaître un certain tournant. Celui-ci était surtout lié à l’émergence de nouveaux acteurs dans la discussion, et de l’apparition de nouvelles finalités auxquelles des instruments scientifiques et statistiques spécifiques peuvent être consacrés. Un élément important est la montée en puissance des politiques d’entreprises portant sur la « diversité ». Au niveau central de ces entreprises, dans leurs directions de ressources humaines, on est à la recherche d’instruments de gestion appropriés. Un article résume ainsi la situation : « De grandes entreprises, très en pointe dans la lutte contre les discriminations, sont loin de partager ce point de vue (note : celui du refus des statistiques ethniques). Dans la revue ‘Respect Magazine’, Patrick Gagnaire, responsable de l’association SolidarCité, émanation du groupe PPR (Pinault-Printemps-Redoute), défend l’usage des statistiques ethniques pour faire avancer les politiques de recrutement : ‘Nous comptons 80.000 salariés chez PPR. Comment fonctionner sans statistiques fiables ? Comment modifier une photo que nous n’avons pas ?’ Pour certains, ces données raciales devraient même faire partie des bilans sociaux des entreprises. La remarquable pugnacité d’une poignée de patrons pour lutter contre les discriminations à l’embauche rejoint, en réalité, un intérêt bien compris : recruter des salariés est pour eux la garantie d’être au plus près du visage de la France d’aujourd’hui, et donc de leur clientèle. Ce n’est pas un hasard si les hypermarchés sont souvent à la pointe dans ce combat. » (V. Thierry Leclère : « Faut-il des statistiques ethniques pour lutter contre les discriminations ? », Télérama, 15 mars 2006.) En réalité, les motivations d’une partie du patronat qui la poussent à adopter une politique volontariste en matière de « diversité », sont multiples. A côté de la volonté de promouvoir une image de marque (comme c’est décrit dans l’article précité), dans un contexte de concurrence économique exacerbée, on trouve aussi celle d’échapper à tout danger de tomber sous la coupe des nouvelles législations anti-discriminations afin de ne courir aucun risque financier. On retrouve aussi la volonté de ne pas « gâcher » des talents, détenus par des groupes de population jusqu’ici relativement marginalisés, qui resteraient inexploités si on ne s’efforçait pas de combattre les discriminations. Enfin, pour certains acteurs économiques au moins, une conscience citoyenne personnelle peut s’y ajouter également. Quoi qu’il en soit, il résulte de cette volonté de mener une politique de « diversité », à partir du niveau central des directions d’entreprises, une nécessité de pouvoir « planifier » cette diversité relative aux origines et à l’appartenance ethnique. D’où une certaine aspiration à disposer d’éléments de mesure appropriés. Deuxièmement, on assiste à la montée en importance de certains acteurs sociaux (et politiques) qui aspirent à exprimer la volonté d’une communauté jusqu’ici négligée, et le cas échéant aussi de revendiquer un poids électoral (éventuel) de ces communautés. C’est le cas par exemple du Conseil représentatif des associations noires (CRAN), qui, en 2006, avait commandé un sondage à l’institut SOFRES visant entre autres à compter les personnes « noires » en France. Le sondage aboutira à la conclusion qu’environ 4 % de la population française âgée de plus de 18 ans se définit elle-même comme « noire ». Le CRAN présentera publiquement, fin janvier 2007, les résultats selon lesquels 56 % des Noirs vivant en France se sentent discriminés, d’après ce que les personnes interrogées exprimaient aux sondeurs. Au nom de la lutte contre les discriminations, le CRAN soumit aussi un questionnaire aux différents candidats à la présidence de la République pour demander leur opinion sur une éventuelle admission des « statistiques ethniques ». Comme cette demande émanait d’une organisation plutôt marquée comme antiraciste, et était justifiée par la volonté de combattre les situations de discrimination, les ouvertures aux « statistiques ethniques » furent visibles. Surtout, on observait un net éclatement des clivages « Gauche // Droite » autour de cette question. Ainsi pouvait-on lire en février 2007 : « Nicolas Sarkozy juge les statistiques ethniques ‘nécessaires et utiles’, sous couvert d’anonymat (…). Dominique Voynet y est favorable, comme Marie-George Buffet et François Bayrou, sous certaines conditions. ‘On ne gagne rien à se cacher la diversité de notre peuple’, écrit le candidat de l’UDF. Seule Ségolène Royal y est formellement opposée. Selon la socialiste, la gestion des statistiques de la diversité est ‘très délicate’, ‘à cause du risque de fichage’. » (Didier Arnaud et Fabrice Tassel : « Pas d’ethnique dans les statistiques », Libération, 23 février 2007.) Troisièmement, en parallèle à ces deux autres processus, il y avait cependant bel et bien aussi une évolution d’une bonne partie de la droite qui la poussait à intégrer des aspirations à une gestion « ethnicisée » de la société. Sous l’impulsion des politiques sécuritaires et néo-droitières aux États-Unis – qui, par exemple dans le cadre du programme de « Tolérance Zéro » à New York, impliquent aussi un fichage de l’origine ethnique des délinquants p.ex. – et des discours qui y sont en vogue sur le caractère « plus criminogène » de certaines communautés. Sous l’influence de discours néoconservateurs, qui cherchent à accréditer l’idée qu’une grande partie du positionnement des individus (et, partant, des groupes de population) sur l’échelle sociale relève de l’« inné ». (Une vision que Nicolas Sarkozy a fait partiellement sienne, lorsqu’il évoquait dans son célèbre entretien au « Philosophie Magazine » du mois d’avril 2007 le caractère prétendument inné – dû aux chromosomes, à la programmation génétique des individus – des tendances au suicide ou à la pédophilie.) C’est bien Nicolas Sarkozy qui aura fait « bouger » les frontières politiques sur l’ensemble de ces questions, puisqu’il s’est avéré capable de s’appuyer sur ces trois processus ou ces trois acteurs à la fois. En effet, Nicolas Sarkozy s’est prononcé, à partir de 2004 notamment, en faveur de l’idée de conduire des programmes de « discrimination positive ». Il est favorable aux programmes « de diversité » dans les entreprises, et se prononce en même temps pour certaines politiques publiques s’adressant à des « minorités visibles ». A l’instar de ce se qui passe en cette direction aux États-Unis, des programmes ciblés devraient permettre à certains membres des groupes minoritaires – notamment des « minorités visibles » - de grimper dans la hiérarchie sociale. Si cela est a priori positif, Sarkozy s’adresse cependant surtout à l’élite sociale au sens des différentes « communautés » ou « minorités » de la population. Or, pour mener à bien une telle politique, il peut être utile de disposer d’outils de mesure statistiques qui prennent en compte les origines « ethniques » des personnes potentiellement concernées. Nicolas Sarkozy profite de la même occasion pour communautariser le débat social, en s’adressant à des groupes définis par leurs origines de façon séparée, au lieu de soulever la question des choix de société devant la société toute entière. Enfin, Nicolas Sarkozy est également favorable – pour le moins sous certains aspects – aux politiques néo-droitières, qui font incomber la responsabilité de leur conduite sociale aux individus (et potentiellement aux groupes dont ils font partie) en raison de leurs caractéristiques « innées », plutôt qu’à un contexte social et économique. Allant dans cette direction, Nicolas Sarkozy s’est notamment prononcé, le 13 février 2006 sur la chaîne de radio RMC, pour un décomptage des délinquants et des détenus dans les prisons françaises, en fonction de leur origine ethnique. Le ministre de l’intérieur déclara alors, sur ce point : « Il faut faire de la transparence. Il n’y a aucune raison de dissimuler un certain nombre d’éléments qui peuvent être utiles à la compréhension de certains phénomènes. » (V. Jacky Duran : « Sarkozy s’intéresse à la couleur des délinquants », Libération, 14 février 2006.) A ce point-là, nous ne nous trouvons clairement plus sur le terrain du combat contre les discriminations sous toutes les formes… mais bien plutôt sur le terrain où sont créées les discriminations, et les discours qui les légitiment. Quand on parle de « statistiques ethniques », de leurs chances et risques, il arrive aux différents acteurs de parler de choses bien différentes. Ce n’est effectivement pas tout à fait la même chose, que de demander lors d’un sondage (au terme duquel aucune donnée personnelle relative aux individus qui y ont participé, n’est conservée) à des personnes si elles-mêmes se sentent « noires » et quelles conséquences sociales elles y attachent ; ou de préparer et conserver un fichier dans une entreprise ou dans une administration, comportant des données individuelles relatives à des personnes qui sont (potentiellement) identifiables. Cependant des risques peuvent être attachés aux deux hypothèses, dans la mesure où même une collection de données d’ordre général et impersonnel et sur une base volontaire (comme dans notre premier exemple) peut servir de base à l’élaboration d’un discours justificateur des « différences naturelles »… ou plutôt naturalisées, ethnicisées. Tout (ou presque) dépendra, en fin de compte, de l’objectif assigné à la démonstration : des données peuvent être utilisées, afin de démontrer ce que l’on a décidé de vouloir démontrer. A titre d’illustration, reprenons un exemple évoqué plus haut. Quand Nicolas Sarkozy se prononce, au nom de la « transparence », pour l’idée de relever et enregistrer les « origines ethniques » des délinquants condamnés ou des détenus dans une prison : que pourra-t-on chercher à démontrer avec ces données, précisément ? Dès lors qu’on a décidé de démontrer que les jeunes Français d’origine immigrée et dont les familles appartiennent aux catégories sociales « populaires » sont traités plus durement par la police et la justice, sont soupçonnés plus rapidement d’une conduite hors la loi et contrôlés nettement plus souvent par les forces de l’ordre – on y arrivera sans peine. Cependant, si on a décidé de démontrer que « les Arabes (ou les Noirs ou les ….) forment une communauté plus criminogène que les Français blancs et de souche », partant d’un a priori ethniciste, on pourra néanmoins (probablement) aussi aboutir à la démonstration recherchée. En effet, dès lors que l’on fait abstraction d’autres variables – notamment de la composition de chaque groupe de comparaison en générations, classes sociales et positions occupées dans la société – pour uniquement se concentrer sur le seul critère des origines, on arrivera PEUT-ETRE, avec un peu de mauvaise foi toutefois, à établir un « taux de crimes et délits » plus élevé pour un groupe que pour un autre. L’écart ne se réduira probablement que dès lors que l’on tiendra compte d’éléments complémentaires tels que la situation sociale des intéressés, leur rapport à la société dominante (en fonction de l’image que l’on peut cultiver d’elle), de la proportion des classes d’âges ou des stratifications sociales présentes dans chaque groupe de société, etc. Très souvent, les différences entre groupes de comparaison (fondés sur des critères « ethniques » que l’on trouvera), reflètent l’aboutissement d’un processus de construction de catégories sociales qui sont souvent ethnicisées. Une image négative, ethnicisée, collée à un groupe, peut conduire à un processus de désintégration sociale qui, à son tour, pourra mener à une inclinaison plus forte parmi certains membres (jeunes, masculins, d’origine populaire…) de ce groupe vers des conduites qui le mettront en conflit avec la loi. De ce point de vue, la formulation de l’amendement parlementaire qui, le 13 septembre 2007, a introduit le nouvel article 20 dans le projet sur l’immigration afin d’autoriser les « statistiques ethniques » révèle des ambiguïtés dès le départ. En effet, il est question, dans le texte de l’amendement et du nouvel article 20 du projet de loi, de permettre des études « sur la mesure de la diversité (…), de la discrimination et de l’intégration ». Le premier de ces trois termes se réfère clairement aux politiques « de diversité » menées dans les entreprises. Reste les deux autres termes. Ici, nous avons deux approches possibles, qui seraient l’une et l’autre également compatibles avec le texte. D’un côté, nous avons la possibilité de mener, de façon classique, des études sur l’étendue des discriminations : quelles sont les chances (statistiquement parlant) d’un Français d’origine autre que « blanche et chrétienne », de trouver un emploi, un logement… ? De l’autre côté, il sera aussi envisageable d’inverser la problématique… en reformulant la question. Soulevons la problématique, non pas au titre de la « discrimination », mais sous celui des « difficultés d’intégration » de tel ou tel groupe, et l’optique change ! Là, il ne s’agit plus nécessairement de considérer que tel ou tel groupe pourrait faire l’objet de discriminations diverses, mais de mesurer son « degré d’intégration », ses « difficultés d’adaptation »… Au final, on pourrait donc aussi lancer une piste de recherche en posant la question de savoir pourquoi tel ou tel groupe spécifique « s’intègre si mal, dans la société française ». Là, les résultats que l’on obtiendra ne nous aideront plus à combattre les discriminations, mais ils serviront plutôt à les justifier, en les « expliquant »… Tout dépendra, en effet, de ce que l’on recherche à démontrer. Un autre exemple. Un site, douteux, avait réagi à la proposition de Nicolas Sarkozy d’enregistrer l’origine ethnique des délinquants, en proposant de façon provocatrice d’appliquer la même règle aux décideurs de l’ordre établi ou à certains d’entre eux : « Pour bien comprendre les grands choix et décisions des élus, Pour bien comprendre les propositions alternatives de leurs adversaires, Pour bien comprendre les choix des directeurs de l’information des chaînes TV et radios, Pour bien comprendre l’analyse des éditorialistes des magazines d’information, Pour bien comprendre les choix et décisions des grands patrons qui influent sur notre vie quotidienne, Pour bien comprendre les débats philosophiques, religieux ou politiques sur les plateaux TV ou radio, Pour bien comprendre les idéologies véhiculées par les auteurs de livres ou de films, Pour bien comprendre et participer à la vie de la cité, Pour bien voter, L’appartenance ou l’origine philosophico-religieuse de ces notables nous aiderait certainement. » (Cf. http://lesogres.org/article.php3?id_article=1635 ). Ce à quoi il est – assez nettement – fait allusion ici, c’est une prétendue origine juive de ces responsables médiatiques, économiques et autres. Si, aujourd’hui, celle-ci relève largement du fantasme, il aurait été probablement possible, il y a plusieurs décennies, de démontrer une plus forte concentration de personnes partageant cette origine parmi les professions intellectuelles. Dès lors que l’on se borne à dire cela, sans y ajouter qu’il s’agissait là du fruit de plusieurs siècles de discrimination et d’exclusion parmi lesquels les juifs d’Europe se voyaient interdits de travailler la terre et d’exercer un nombre important d’autres métiers – les forçant de façon impérative à se consacrer surtout à des métiers liés au commerce -, on peut facilement aboutir à un discours ethniciste justifiant la haine. Aurait-on demandé de mesurer s’il n’y avait pas, là, parmi les journalistes ou les avocats, une « surreprésentation » de tel groupe de la population ? On aurait peut-être pu le démontrer « objectivement », à travers des statistiques même pas truquées, mais en omettant de dire qu’il s’agissait là de l’aboutissement d’un processus de construction d’une catégorie sociale ethnicisée (ou, dans le passé européen, confessionnalisée). Là où la statistique voit un constat « objectif » et chiffrable, il n’y a en réalité que le reflet d’une histoire sociale. Autre critique qui est adressée aux tenants des « statistiques ethniques » : celles-ci comporteraient une « assignation à identité ». En effet, afin de pouvoir remplir les cases d’un questionnaire basé sur l’analyse des « origines ethniques » d’une personne, encore faut-il que cette dernière puisse rentrer dans une catégorie donnée. Pour des personnes issues du métissage, aux origines multiples (ou peu connues, en raison de l’histoire familiale), ou qui refusent elles-mêmes de se voir attribuée une catégorie « ethnique », cela peut se révéler compliqué. Ainsi chaque personne se voit pousser à affirmer un choix plus ou moins clair en faveur d’une « identité » donnée, que la grille proposée consacre. Ces « identités » sont souvent liées à des fantasmes répandus dans la société, auxquelles on est ainsi sommé de s’identifier, à moins qu’on ne soit au contraire sommé de s’en démarquer. Le caractère volontaire de la démarche, et surtout la possibilité de n’effectuer aucun choix – en laissant vide la case correspondant à l’« origine ethnique » - ou d’en effectuer plusieurs à la fois, pourra partiellement amoindrir cette pression. Cependant elle peut toujours exister, émanant aussi de l’intérieur d’une communauté elle-même, qui peut chercher à se mesurer, à quantifier son poids dans la société. On accéderait ainsi à une reconnaissance sociale « parce qu’ » on est Noir, ou Asiatique, ou de telle ou telle origine, puisque cette communauté sortirait enfin de l’ombre. Il faudrait ainsi passer par l’affirmation de son appartenance à ce groupe, et par la reconnaissance de la nécessité sociale de ne plus marginaliser ce dernier, pour délégitimer le fait de se voir assigné aux logements « pourris » dans des zones périphériques, aux travaux les plus mal rémunérés et les moins considérés… Il y aurait cependant aussi un autre chemin : celui où la société affirmerait qu’aucune personne, quelque soit son origine (cette dernière ne pouvant pas valablement être prise en compte pour déterminer son statut social) ne doit vivre dans un logement « pourri », dans une zone mal desservie par les transports, en étant payé un salaire « de misère ». Ceci parce que les logements « pourris » et les salaires « de misère » ne doivent pas exister. Enfin, une dernière critique qu’il est possible d’adresser aux « statistiques ethniques », se rapporte à la pratique là où ces dernières existent déjà : la consécration de l’arbitraire qui existe souvent dans la définition des catégories qu’il faudrait retenir. Aujourd’hui, les collectes de données à caractère « ethnique » sont pratiquées, de façon « décomplexée », surtout aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Une des catégories utilisées est celle de « Race » (en anglais), terme moins chargé de significations lourdement négatives dans cette langue que dans les langues française et allemande, notamment. Cependant, il s’avère que la conception de ce qui relève de la « Race » est souvent à géométrie variable. Ainsi, dans un questionnaire utilisé aux États-Unis en 2000 (et présenté, à titre d’exemple, aux participants à la séance de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, CNCDH, du 19 février 2007), le critère « The person’s race » - « La race de la personne » - pouvait être attribué en cochant p.ex. la case « Blanc » ou « Noir ou Afro-Américain ». Dans les deux cas, il s’agit de références à la couleur de la peau, pouvant néanmoins recouvrir des origines diversifiées. Ainsi, un Noir résidant aux États-Unis peut être issu des populations fixées en Amérique du Nord par l’esclavage des 18e et 19e siècles, de l’immigration haïtienne ou antillaise beaucoup plus récente ou encore être directement issu d’une famille originaire du continent africain (comme c’est le cas de l’homme politique Barak Obama, dont le père n’était pas « Afro-Américain » aux ancêtres esclaves mais un ressortissant kenyan. Cependant, à la rubrique « Blancs », une sous-rubrique « Hispanic » (Latino) est proposée. Ici, il ne s’agit ni d’une couleur de peau ni d’une origine géographique précisé, mais d’un critère essentiellement linguistique. Par contre, en ce qui concerne les personnes d’origine asiatique, la logique change encore. En effet, pour eux sont prévues (parmi d’autres) les rubriques « Indiens », « Chinois », « Philippins », « Japonais », « Coréens », « Vietnamiens »… Il est évident qu’ici, il s’agit avant tout de nationalités. A la différence des « Noirs », les Asiatiques ne figurent pas comme « Jaunes » - terme péjoratif -, ni classés par appartenance linguistique comme les « Hispanics » (puisque l’Inde est un pays multilingue). Il s’agit bien, ici, de retracer les frontières entre États-nations, même si dans certains cas – ceux de l’Inde et de la Chine – il s’agit de la continuation moderne d’anciens Empires tout à fait… multiethniques. Ainsi aucune cohérence au fond ne se dessine à travers les catégories utilisées. Alors que les citoyens d’origine européenne et africaine sont définis par leur couleur de peau, alors que dans des périodes précédentes les Américains d’origine irlandaise et les « Italo-américains » formaient bien des communautés propres tout à fait à part, , les « Hispanics » sont définis par leur langue et les Asiatiques par leur nation d’origine. On ne saurait guère mieux démontrer qu’il s’agit là d’une pure construction sociale et non point d’une catégorie scientifiquement « objective ». Si des personnes, tout à fait attachées à la lutte contre les discriminations, pensent trouver un intérêt à l’établissement de « statistiques ethniques » au nom même de ce combat, il y a une raison majeure à cela. La réalité historique démontre que l’universalisme républicain français, tel qu’il a été prôné et pratiqué, a trop souvent dissimulé la réalité des discriminations. Prétendant être « aveugle » à la couleur, à la confession, aux origines des personnes (pour ne retenir que leur nationalité comme seul critère de distinction), ce discours républicain a souvent masqué l’étendue des discriminations que subissaient néanmoins des groupes de la société en raison de leurs origines. En effet, si l’on entend sans cesse affirmer qu’on a les mêmes droits que les autres personnes puisqu’on a une carte nationale d’identité française, mais que l’on se voit néanmoins refuser l’accès à un emploi, un logement… en raison de son appartenance à une « minorité visible », on finit par ne plus croire à cette affirmation d’égalité et d’universalisme. Si l’idéal républicain n’opère pas des distinctions entre groupes liés aux origines, la société, elle, connaît néanmoins ces distinctions. Aujourd’hui, cette réalité-là est très largement reconnue. Depuis 1999, les différents gouvernements successifs ont publiquement avoué l’existence et la persistance des discriminations dans la société française, en y consacrant des mesures et des lois telles que la « loi pour l’égalité des chances » adopté an mars 2006 sous le gouvernement de Dominique de Villepin. (C’est une autre question de savoir quelles mesures concrètes ont été adoptées dans le cadre de ces législations. La « loi pour l’égalité des chances », adoptée au nom de l’amélioration des opportunités d’accéder à un emploi, a par exemple pris prétexte de cette nécessité pour tenter de démanteler le droit du travail. Elle comporte, parmi d’autres mesures, le « Contrat première embauche », CPE, qui déplaisait plutôt à une large portion de la jeune génération en France…) Là se trouve la faille, qui a pu permettre aux partisans de l’établissement de « statistiques ethniques » de s’engouffrer en pointant du doigt les contradictions ou les limites historiques de l’« universalisme républicain ». Néanmoins il existe d’autres moyens, comportant moins de risques que l’autorisation des « statistiques ethniques », d’y porter remède et de lutter – plus efficacement même – contre les discriminations. Premièrement, il s’agit de l’autorisation (désormais consacrée par la loi) des opérations de « testing ». Nous n’avons pas besoin de mesurer le nombre total de personnes « blanches » et « noires » qui rentrent dans une boîte de nuit, pour établir une statistique de la fréquentation « ethnique » de cet établissement, pour voir s’il existe éventuellement une discrimination. Il suffit de constater, dans une situation réelle (produite, provoquée par les opérateurs du « testing »), que telle personne concrète de couleur de peau « noire » n’a pu entrer dans tel établissement, au prétexte que celui-ci serait plein, alors que telle autre personne de couleur de peau « blanche » pourra y entrer facilement quelques minutes plus tard. A travers la situation concrète, la flagrance d’une discrimination est ainsi établie. Pour cela, point besoin de demander à tous les autres hôtes de l’établissement de bien vouloir déclarer s’ils se sentent « blanc », « noir » ou autre chose. Deuxièmement, il faudra s’appuyer sur l’amélioration des leviers juridiques dont disposent les victimes individuelles de discriminations. Avec l’aménagement de la charge de la preuve, opéré par la loi française contre les discriminations du 16 novembre 2001 (sur fond d’évolution du droit européen), les victimes ont plus de facilités à combattre juridiquement les discriminations auxquelles elles font face. Il suffira d’établir la réalité d’un traitement différent entre deux (ou plusieurs) personnes placées dans une situation identique ou comparable, par exemple de deux salariés accomplissant le même type de travail, pour contraindre l’auteur potentiel d’une discrimination à justifier à son tour son comportement, en s’appuyant sur des critères de distinction non discriminatoires au sens de la loi. Ainsi, pour justifier une différence de rémunération entre deux salariés ayant la même activité, l’employeur devra être en mesure de pouvoir justifier ses décisions en invoquant des raisons liées à la qualification professionnelle, à la qualité du travail, aux performances… S’il n’y parvient pas, on retiendra à sa charge qu’il y a eu violation de la prohibition des discriminations. Aujourd’hui, il s’agit d’affiner ces instruments juridiques afin de faciliter leur utilisation, notamment en permettant aux personnes potentiellement victimes de discriminations de surmonter la difficulté d’obtenir des preuves de cette situation. Mais cela ne nécessite pas de procéder à une cartographie « ethnique » de tout le personnel d’une entreprise ; il s’agit plutôt de fournir les outils et soutiens nécessaires à chaque travailleur pour pouvoir se défendre, individuellement, dès lors qu’il fait face à une discrimination. ` Au-delà de ces instruments, il y a une question de fond : celle de la consécration d’un droit général à l’égalité de traitement, pour toutes et pour tous, au lieu de voir se multiplier les règles spécifiques de lutte contre les discriminations, voire les « discriminations positives ». Au lieu de reconnaître aux membres de tel ou tel groupe de ne plus se voir de facto forcés de se loger dans des habitations insalubres et dangereuses aux centres ou périphéries des agglomérations urbaines, faisons plutôt en sorte que personne ne soit contraint de loger dans ce type d’habitations ni dans des localités socialement marginalisées. Il s’agirait, au fond, de passer d’un droit de la non-discrimination spécifique à un ensemble de règles au sommet duquel trône, en quelque sorte, un principe d’égalité de traitement. Cette évolution ne serait-elle pas quelque peu paradoxale... vu que, dans le même temps, le nombre de cas de figure de discriminations illicites a augmenté en droit positif français ? Ainsi la loi du 06 novembre 2001, en matière de lutte contre les discriminations, a-t-elle ajouté cinq nouveaux cas de discrimination prohibée à l’art. L. 122-45 du Code du travail français : la discrimination à raison de l’orientation sexuelle ; de l’apparence physique ; du patronyme ; de la non-appartenance (vraie ou supposée) à une nation, ethnie ou « race » ; et à raison de l’âge. De plus, la loi du 04 mars 2002 sur les droits de la malade y ajouté un autre motif de différenciation illicite, résultant de la prise en compte des caractéristiques génétiques d’un individu. Mais c’est, nous semble-t-il, justement en raison de cet allongement considérable de la liste des motifs s’opposant à une différenciation légitime que le passage général à une exigence d’égalité de traitement (consistant à demander que les distinctions soient justifiées par celui qui les opère) nous semble tout à fait judicieux, voire nécessaire. La multiplication des cas de discriminations prohibées par le législateur n’est que le reflet d’une prise de conscience de la société sur elle-même : de la société qui s’aperçoit que les sources potentielles de traitement injuste sont nombreuses et que les risques qui y sont liés pourraient encore s’accroître en raison des « progrès » des nouveaux moyens technologiques de collecte et de traitement de l’information qui permettent potentiellement de rassembler encore plus d’informations sur un individu. Les caractéristiques génétiques pourraient également, un jour, être prises en compte puisque les outils technologiques le rendraient possible ! Or, face à la multiplication de tels risques, convient-il de multiplier parallèlement le nombre de critères dont il faudrait expressément vérifier s’ils on, ou non, pu fonder telle décision ou telle différenciation de traitement ? Et que faudrait-il faire si la personne ayant subi une décision désavantageuse, n’a aucune certitude quant au fait que tel ou tel élément la concernant était connu ou non par l’auteur de la décision considérée ? Prenons deux exemples. Le salarié est homosexuel mais pense que son employeur n’est pas au courant de cet état des choses. Avec le temps, il constate qu’il est plus souvent écarté des augmentations salariales individualisées dans l’entreprise que d’autres collègues de travail. Pour savoir s’il peut demander une réparation à l’employeur sur la base d’une discrimination illicite commise par celui-ci, doit-il alors lui-même révéler son homosexualité pour avoir le droit d’agir, pour être en mesure de présenter des « éléments de fait » laissant paraître plausible l’existence d’une telle discrimination ? Autre exemple : dans le secteur des services, certaines qualités liées à la personne des salariés - dont l’apparence physique - peuvent prendre une importance accrue à partir du moment où les salariés entrent en contact avec la clientèle. Un(e) salarié(e) se voit fréquemment désavantagé(e) en termes de répartition du travail et, en conséquence, de rémunération. Il ou elle pense que cela pourrait être dû aux fait de ne pas correspondre aux « canons de beauté » de l’employeur. Le salarié devra-t-il alors activement revendiquer, pour pouvoir invoquer une discrimination illicite (sur la base de l’art. L. 122-45 du Code du travail complété par la loi du 16 novembre 2001, critère : « apparence physique »), l’appartenance à une catégorie de « non-beauté » ? On imagine les difficultés, psychologiques comme juridiques, auquel on exposerait la personne concernée. Pour de tels motifs, il paraît nécessaire de passer à une logique plus globale. Au lieu de demander à la personne qui se croit victime d’une décision la désavantageant, de bien vouloir « rentrer » à tout prix dans l’une des multiples cases spéciales, l’une de ces catégories particulières censées le/la protéger d’une discrimination fondée sur un motif précis (quitte à lui demander de deviner quel aurait pu être le véritable motif de celui qui a pris la décision), on pourra ainsi exiger des « décideurs » qu’ils motivent leurs décisions, qu’ils justifient les différences de traitement. Cela peut permettre de détecter les motivations « suspectes », sans pour autant que la victime ne se voit obligée de révéler celles parmi ses différentes caractéristiques personnelles qui auraient pu attirer les « soupçons ». Cela permet également une certaine réunification de la société face aux discriminations et inégalités de traitement. Le fait de contraindre toute aspiration à l’égalité, ou à une certaine justice dans le traitement, à passer par la prohibition de discriminations spéciales/spécifiques, est susceptible d’atomiser la société en de multiples groupes ou « communautés » cherchant avant tout à se protéger eux-mêmes et elles-mêmes. La lutte contre les discriminations pourrait ainsi, sous certaines circonstances, aboutir « à une réglementation catégorielle, qui a un parfum de privilège » (selon Jacques BORE : « La Cour de cassation et le principe d’égalité », Droit social 1987, p. 139.). Mieux vaut donc donner âme et corps à un universalisme qui n’existe pas seulement au niveau de l’affirmation, mais se trouve ancré dans la réalité. Cette page a été mise à jour le dimanche 30 septembre 2007 |
|
Vous êtes le visiteur depuis le 27 novembre 2006 (Lycos)
Vous êtes le Ce site est présent sur deux serveurs : http://mrap54.free.fr http://membres.lycos.fr/mrapnancy Actualité immédiate sur http://mrapnancy.over-blog.com |